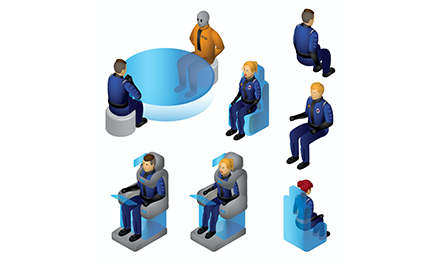Au commencement était le texte. Avec ses voyelles, ses consonnes et sa ponctuation. Au Moyen-Age, quelques moines studieux décidèrent de glisser des commentaires entre les lignes, puis, pour gagner en clarté, de les déplacer dans les marges à l’aide d’astérisques. Plus tard, au XVIe siècle, Richard Jugge, l’imprimeur de la reine Elisabeth, chargé d’éditer la nouvelle Bible anglicane annotée à partir de la version calviniste en vigueur, eut une idée pour mettre de l’ordre dans les commentaires : les reléguer dans un espace dédié sous le texte. Ainsi, dans une imprimerie, la note de bas de page naquit de l’union de la rhétorique et de la calligraphie.
Fastidieuse à lire autant que pénible à produire, celle-ci devient vite le cauchemar des lecteurs et des thésards. Pour le dramaturge britannique Noël Coward, « Lire une note en bas de page revient à descendre pour répondre à la porte alors qu’on est en train de faire l’amour. »
Elément du paratexte, la note a tout du parasite. Pourtant tout avait bien commencé. Ce fut d’abord une histoire d’historiens. La note venait répondre à un besoin à mesure que l’histoire gagnait en scientificité : la nécessité de citer clairement ses sources et l’importance croissante accordée aux preuves pour étayer chaque thèse.
Mais peu à peu, la note semble prendre sa mission de vérification trop au sérieux. L’éloquence primesautière se fige en prose officielle, on passe du salon de conversation au bureau du greffier : op.cit., ibid, loc.cit., cf.supra, q.v., et al.
Balzac se gausse d’Eugène Sue qui, dans son roman Les Mystères de Paris, commente en bas de page les dialogues de ses personnages : « Une note est le coup d’épingle qui désenfle le ballon du romancier. »
Dans les ouvrages scolaires, les notes prolifèrent. Elles sont ennuyeuses, superflues (définition d’un mot que l’élève aurait mieux fait de chercher dans le dictionnaire), dévoilent trop tôt l’intrigue qiu va suivre (« vous noterez les éléments qui annoncent le suicide à venir du héros ») et renvoient même à d’autres notes sur d’autres pages…
Cependant, dans son Histoire du déclin et de la chute de l’empire romain, Edward Gibbon élève la note de bas de page au rang des beaux-arts. Ses notes sont des feux d’artifice rhétoriques, poétiques ou humoristiques. Leur irrévérence religieuse et sexuelle divertissait ses amis et enrageait ses ennemis. Mais tout le monde n’est pas Edward Gibbon, ou Jonathan Swift, Henry Fielding, Georges Perec ou David Foenkinos, dont les notes de bas de page sont un régal comme le corps du texte.
Paul Vacca – Les Echos – 16 septembre 2022
Anthony Grafton – Les Origines tragiques de l’érudition – Une histoire de la note en bas de page (Seuil – 1998)